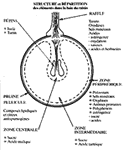...Suite Champagne
|
Propriété du négoce |
Propriété des viticulteurs |
Total |
||
|
Ha |
Nombre |
Ha |
||
|
1950 |
1
314 ha |
9
543 ha |
10
957 ha |
|
|
1988 |
3
000 ha |
13 000 viticulteurs |
25
600 ha |
28
800 ha |
|
1995 |
3
000 ha |
27
800 ha |
30
800 ha |
|
|
Solde de la “Réserve légale 1927” |
3 365 ha |
|||
|
Horizon des années 2 000 |
3
000 ha |
31
165 ha |
34 165 ha |
|
Près de 10
000 marques ! Près de 10 000 qualités !
Un “manipulant” est
toute personne physique ou morale qui procède elle-même,
dans ses locaux, pour son propre compte ou pour le compte de tiers,
à l’élaboration de vins de champagne et à leur
présentation en bouteilles habillées propres à
la commercialisation.
Ces manipulants, obligatoirement inscrits au registre du Comité
interprofessionnel des vins de champagne (CIVC) sont repérables
par les initiales NM, CM, RM, RC, suivies d’un numéro sur la
capsule et sur l’étiquette.
NM = Négociant Manipulant : propriétaire ou
non d'un vignoble, il achète des jus provenant de raisins vendus
par des viticulteurs. Il les champagnise après assemblage avec
les vins provenant de ses propres vignes. Il commercialise les marques
qui lui appartiennent en propre.
CM = Coopérative de Manipulation : La cave champagnise
et commercialise les vins résultant d'apports de viticulteurs
RM = Récoltant Manipulant : vigneron qui champagnise et
commercialise tout ou partie de sa récolte.
MA = Marque Auxilliaire. Des propriétaires de marques
MA, étrangers à la profession champenoise, se fournissent
en bouteilles champagnisées auprès de l’un ou l’autre
des autres opérateurs ci-dessus. Ces MA sont principalement les
grandes enseignes de distribution qui se sont "inventés"
des noms de fantaisie, à apparence généalogique
ronflante. Elles font fonctionner ce marché de marques auxilliaires,
pour lequel la société Marne et Champagne s'est spécialisée.
Pour une quantité substancielle (de l'ordre de 10 000 bouteilles
par an), vous pourriez, vous aussi, avoir votre champagne à votre
nom, qui serait une marque auxilliaire de votre fournisseur.
RC = Récoltant Coopérateur : viticulteur qui apporte
ses raisins à une coopérative, qui champagnise, et propose
la bouteille terminée, bouchée et muselée, prête
à être étiquetée par le viticulteur qui l'aura
récupérée pour la vendre lui-même.
|
Manipulants |
Propriétaires
de marques |
Total |
|||
|
NM |
CM |
RM |
|||
|
Entreprises |
230 |
70 |
4 800 |
5 100 |
|
|
Marques |
950 |
200 |
6 000 |
2 000 |
9 100 |
Potentiels
organoleptiques des 3 cépages
Chardonnay :
seul cépage blanc autorisé en Champagne. Jeune, ses qualités
aromatiques se distinguent par des notes florales (aubépine,
acacia) et fruitées (pomme, poire). Il apporte à l’assemblage
fraîcheur, légéreté et finesse. A l’évolution,
la noisette se développe pour aboutir après un long vieillissement
à des arômes de café caractéristiques des
vieux millésimes.
Pinot noir : sur les rebords de la Montagne de Reims, il donne des arômes de petits fruits rouges (cassis, fraise, framboise). Les chefs de cave le recherchent pour donner volume et rondeur à leur cuvée. En vieillissant, il évolue vers des arômes plus marqués de feuilles mortes, puis organiques.
Pinot meunier : il constitue le vignoble de la Vallée de la Marne. La modestie de ses qualités dans son jeune âge donne des vins neutres. Il a une évolution rapide qui permet aux assemblages auxquels il est associé d’être commercialisés plus tôt.
Evolution des 3 cépages, à équivalence de rang de fractionnement
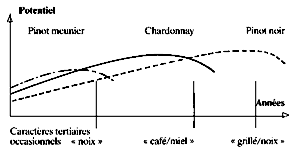
Potentiel selon le niveau de classement des communes
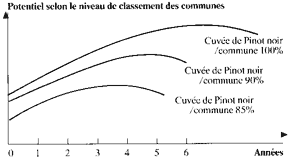
Potentiel selon le rang de fractionnement
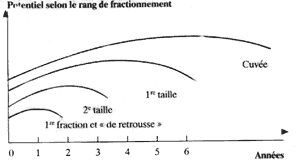
La
spécificité champenoise
De nombreuses régions vinicoles savent faire des bulles à
l'intérieur des bouteilles selon la méthode champenoise.
(Chapitre "Les crémants, sparkling wines, et autres mousseux"
en préparation).
Cependant, il n'en existe pas qui ait érigé un système réglementaire, donc obligatoire pour tous les producteurs, qui commence par des règles strictes de pressurage.
| Structure
et répartition des
éléments dans la baie du raisin La méthode champenoise consiste à isoler au moment du pressurage les différents jus qui peuvent être extraits du grain de raisin cueilli par grappe entière (Machine à vendanger encore interdite en 2000 ; transport des raisins en caissette de 40 à 50 kg, sur couche de 30 à 40 cm, sans écrasement des caissettes superposées au cours de leur transport et de leur stockage dans les files d’attente du centre de pressurage ; caissettes à fond percé pour laisser s’écouler le jus éventuel, ou la pluie dans le cas de vendanges sous la pluie). |
Traditionnellement 100 caisses de 40
kg remplissent un marc de 4 000 kg sous le pressoir horizontal
immortalisé dans des milliers de photos et de films.
Les grandes Maisons continuent à entretenir ce "folklore"
au moment des vendanges...
Mais la plupart des centres de pressurage sont maintenant équipés
avec des pressoirs pneumatiques à membrane latérale, ou
à membrane supérieure de contenance multiple de 4 000 kg
= marc, unité de mesure d'un lot de pressurage champenois.
|
Fractionnement idéal des moûts à partir d’un marc de 4 000 kg 1ère fraction =
environ 100 litres |
2ème fraction = 1 800
litres = la CUVEE
A la pression de 1 kg/cm2, les grains libèrent le jus de la zone
intermédiaire qui se filtre dans les drains formés par
les rafles. Richesse élevée en sucre, en acide tartrique,
en acide malique, et présence de précurseurs d’arômes.
Il faut 2 à 3 “serres” séparées par une “retrousse”,
en 2h30 environ, pour obtenir le moût limpide, non taché, non
oxydé, qui caractérise dans chaque site le meilleur de
la qualité potentielle.
C’est également ce jus qui a aussi les plus fortes possibilités
de moussabilité.
Fractions des “retrousses” =
2 ou 3 fois x 100 litres
(“retrousse” = émiettement du gâteau du marc au moment du desserage
du pressoir ).
Après chaque retrousse, les 100 premiers litres devraient être
séparés de la cuvée, car ils présentent
des caractères proches de ceux de la 1ère fraction.
3ème fraction = la 1ère
taille = environ 400 litres
A la pression de 1,2 kg/cm2, c’est le jus de la zone centrale, et celui
de la zone périphérique, qui sous l’effet de la pression
croissante du pressoir, se libèrent des vacuoles des cellules
de ces zones. La composition du jus s’enrichit progressivement de tous
les éléments peu qualitatifs :
-
la teinte s’accentue, dans le cas du pinot noir et du pinot meunier ;
-
taux élevé de tous les facteurs défavorables (potassium, matières oxydables, astringentes, herbacées, colorantes), et faible moussabilité.
A la pression de 1,4 kg/cm2, l’extraction des éléments défavorables se poursuit.
Dans la réglementation actuelle, les 2ème tailles ne peuvent pas être utilisées pour la champagnisation. Il n'y a pas encore si longtemps, une grande partie de ces vins de 2ème taille rentraient dans la composition des bouteilles de Champagne à 49,90 FF "produit d'appel" des têtes de gondole des grandes surfaces.
Par la suppression de cette pratique, les "produits d'appel" se sont revalorisés en qualité avec des vins au minimum de 1ère taille et en niveau de prix voisin de 69,90 FF.
Disponibilités des moûts après
pressurage
Au total selon le règlement
de l’organisation champenoise :
Un marc de 4 000 kg de raisins est exploitable en lots isolés
dans des cuvons de contenance correspondante pour :
10 pièces = 2 050 l = 100 l de la 1ère fraction + 1
850 l de la Cuvée + 100 l des retrousses
+ 2 pièces = 410 l de la
1ère taille
Total = 12 pièces = 2 460 l.
Soit un rendement de pressurage de 62% du poids de raisin = volume de
moût.