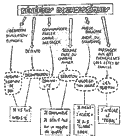...Suite Champagne
Votre
bouteille Cuvée spéciale
Jusqu’à 40 vins venant des meilleures parcelles à
100% de pinot noir, et de chardonnay possédées par les
maisons de négoce sont assemblés pour constituer la Cuvée
spéciale, emblème de la réputation et du prestige
mondial de la maison.
5, 6, 7 ans de stockage sur latte sont nécessaires pour que ce
champagne arrive à son apogée dans sa bouteille spécialement
décorée. Des spécialistes prétendent pouvoir
reconnaitre à la dégustation les dominantes qui marquent
chacune de ces marques de prestige.
Stockage sur latte
d’une cuvée spéciale
(en préparation)
Mais il peut y avoir de très agréables surprises. Et pour ceux qui recherchent le seul effet psychologique de la consommation du Champagne, il ne faut pas se gêner !!!
Les ventes de
Champagne
Une croissance constante du nombre de bouteilles vendues, avec des
crises sévères, 1981, 1991, liées à des
événements économiques qui perturbent le marché
du luxe.
|
Année |
Total en millions de bouteilles |
|
|
|
1979 |
186 |
|
|
La Champagne espérait commercialiser 300 millions de bouteilles pour fêter le passage de 1999 à l'an 2000. Il s'en est vendu 327 millions dans les circuits de distribution !
Et à fin 2000, la Champagne découvre qu'il y a probablement plus de 50 millions de bouteilles qui n'ont pas été achetées par les fêtards pour les fêtes de l'An 2000, et qui encombrent les circuits commerciaux en quantité et en prix.
Conseils ardents pour l'achat : ATTENDEZ QUE LES PRIX S'EFFONDRENT POUR REAPPROVISIONNER VOS CAVES !
Concurrence avec d’autres vins à bulles : l’estimation du marché des vins effervescents est de près de 3 milliards de bouteilles dans le monde entier. Le Champagne représente donc environ 10% du marché des bulles.Voir les Crémants (en préparation).
Les stocks sur lattes et les ventes
Ce cycle de fabrication, “d’affinage” du champagne, entraîne la
présence d’un stock considérable de bouteilles champagnisées
des récoltes antérieures, et de vins de la récolte
la plus récente en voie de l’être.
La Champagne financière et bancaire vit avec un ratio indicateur
de son besoin de financement : les stocks disponibles exprimés
en bouteilles divisé par le volume des expéditions de
la dernière campagne. Ce ratio oscille autour de 3.
Ce cycle technologique oblige un financement considérable, qui demande de plus en plus de capitalisation. Ces “empires de luxe” sont devenus depuis plus d’une décennie les enjeux de maneuvres boursières considérables, dans lesquelles les groupes initialement familliaux éclatent au gré des mouvements de concentration.
Exploration
psychosociologique du Champagne
Au cours d’entretiens qualitatifs, les psychologues de l’IFOP se
sont attachés à décoder l’un après l’autre
chacun des attributs du champagne, différenciés de ceux
de la dégustation, pour connaître ce qu’ils éveillent
de particulier dans la sensibilité profonde de l’individu et
dans ses fantasmes.
-
La couleur : c’est la même que celle de l’or. Elle se situe sur le registre du soleil et de la lumière. Elle appelle l’idée de maturation, de maturité.
-
Les bulles : elles entretiennent une relation avec l’élément “ air ”.
-
La mousse : c’est l’élément “eau” qui fournit le contrepoint.Ces deux attributs relèvent du registre de l’éphémère, de l’instant, du fugitif, du flux du temps.
-
Le bouchon : il est lié au mouvement, à l’impulsion, au dynamisme, à la genèse. Le départ d’un bouchon et la projection du liquide font vibrer la sensualité et même la sexualité...
-
Une légitimité sociale : le territoire des symboles est abandonné pour celui, moins ésotérique, des rapports de société. Le vin de Champagne est considéré comme appartenant au système de valeurs des groupes dominants. Valeur-clé, valeur de référence, il représente du même coup une légitimité à atteindre pour ceux qui appartiennent aux groupes prétendants. La consommation du Champagne implique un certain élitisme. Elle fait partie des rituels.De là aussi le sentiment d’une institution, d’une souveraineté, d’un univers où est inscrit très fort l’image que l’on veut se donner de soi, et celle que l’on veut donner de soi aux autres.Le Champagne est proche de marques analogiques : grande couture, bijouterie, objets et produits de luxe, qui sont porteurs de prestige, et associés à des signes sociaux qui différencient.Attributs symboliques et statut social fonctionnent ensemble : le phénomène Champagne se trouve au croisement des champs de référence des symboles et de ceux de la vie sociale.
-
Différences avec les vins mousseux : les autres vins qui moussent possèdent pratiquement les mêmes attributs extérieurs que le Champagne : la couleur, les bulles, la mousse, le bouchon, sans parler du flacon lui même et de son habillage. Mais la grande différence, pour le public, c’est que tous les signes “sociaux” s’inscrivent en retrait sur ceux du Champagne. Curieusement même, l’enquête a fait apparaître que l’arbitrage entre Champagne et mousseux était plus dur auprès des classes moyennes qu’auprès des classes élevées. Comme si les premières étaient plus rigides encore sur les “signes” que les secondes.Il est significatif aussi que toutes ces transactions de positionnement “d’image” se jouent généralement beaucoup plus sur les signes sociaux que sur les qualités organoleptiques.Les choses sont ainsi qui donnent la préférence au Champagne.
-
Une imagerie à facettes particulièrement riches.
La combinaison des éléments exprimés par l’inconscient crée la haute “image” que se fait le public du Champagne, valorisé par un vocabulaire abondant : généreux, vivant, sensuel, désirable, beau, superbe, émotionnel, authentique, distingué, élégant, respecté, traditionnel, naturel, culturel, intelligent,... Le champagne
-
La consommation du Champagne apporte des “bénéfices psychologiques”
Les différents modes d’emploi de ce produit exceptionnel mettent en valeur les “bénéfices psychologiques” qui en découlent. Le Champagne devient un “alicament”, une “drogue douce de luxe”, par ses effets psychotropes, modérateur des psychoses des temps modernes.
Bénéfices psychologiques
-
L’image du Champagne n’est pas stéréotypée. Des jeunes consommateurs occasionnels le considèrent comme un moyen de donner de l’intensité à des moments d’exception, pour une consommation superficielle qui s’explique par le fait qu’ils ne sont pas encore impliqués dans le jeu social.
Des personnes d’âge mûr, et qui consomment plus souvent auront tendance à apprécier leur insertion sociale, leur confort, leur bien vivre, leur adhésion aux signes institutionnels, leurs références inséparables.
Il existe aussi une catégorie d’amateurs qui consomment fréquemment parce qu’ils veulent profiter de la vie, et qu’ils en ont les moyens. Ils assouplissent les rituels. Pour eux le Champagne n’est pas un phénomène de classe.
Le Champagne fait partie des quelques noms et produits qui pèsent exceptionnellement lourd, affectivement et socialement dans la conscience collective. Signature des grands instants, moyen de rompre avec le quotidien, il apporte beaucoup à l'affectif.
Petite bouteille bleue fluo, d'une contenance de 20 cl. Elle est fermée par un vrai bouchon , avec son muselet. Elle se trouve prioritairement dans les boîtes de nuit à la mode dans les grandes villes européennes et les métropoles mondiales.
POP est franchement individuel, complètement décalé par rapport à la bouteille de 75 cl, conviviale...
POP se boit à la paille (bleue aussi), ou à la bouteille, en dansant, ou en parlant. Il se déplace avec son propriétaire...
Certaines Maisons ont emboîté le pas en proposant pour le même public des quarts classiques avec bouchon à vis (et paille)...
Le
champagne rosé
Dans tous les vignobles européens, l'élaboration d'un
rosé exige une macération pelliculaire courte qui donnera
la couleur désirée du vin
Voir EDUCVIN. Votre talent de la
dégustation.
Chapitre 34. Les mots de la vinification.
La pigmentation se trouvant dans la
peau du raisin, il suffit de laisser cette dernière en contact
dans le jus pendant quelques heures pour que celui-ci prenne une teinte
plus ou moins rose.
Cette méthode découle d'une obligation légale qui
ne touche pas la champagne. Cette région bénéficie
d'une dérogation pour des raisons historiques.
Aujourd'hui en Champagne, les cuvées rosées se multiplient, pour répondre à l'attirance des clients qui les regardent avant de les boire. Dom Perignon Rosé existe depuis 1959 ; Dom Ruinart depuis 1964 ; Bollinger en 1966 ; Pommery avec Cuvée Louise Rosé en 1980 ; Krug Rosé en 1983 et Veuve Clicquot La Grande Dame en 1988, puis tous les autres ont suivi.